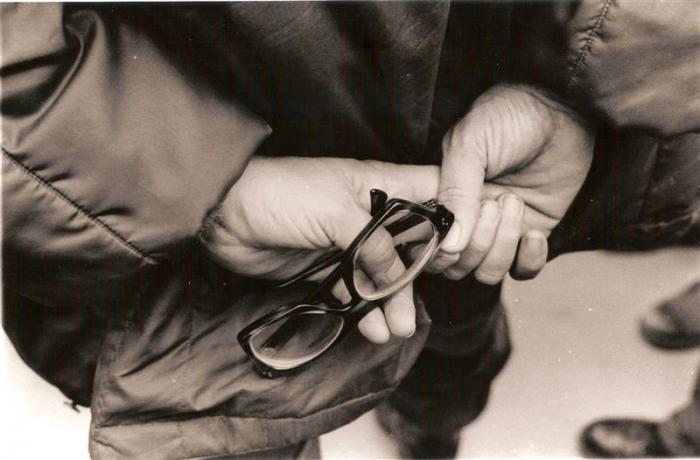
En 1985, un journaliste étranger a demandé à Fidel : « Quel héritage souhaitez-vous laisser ? Comment aimeriez-vous que l'on interprète ce que vous avez accompli au cours de ces années ? ».
Dans une réponse succincte, où il indiquait clairement que son maintien au pouvoir était directement lié à ses devoirs de révolutionnaire et que lui n'était pas indispensable, il affirma : « Je n'ai pas le moindre doute que (...) le concept des gens et la reconnaissance du peuple seront vraiment élevés quant au rôle et aux efforts que j'ai accomplis au sein de la Révolution, sans que cela signifie en aucune façon que cela ait été parfait et exempt d'erreurs, loin de là ; mais je suis sûr de la haute estime qui restera de mes services, absolument sûr, je n'ai pas le moindre doute à ce sujet ».
Il ne se trompait pas. Le canal de communication transparent qu'il établit avec les gens, à travers son éloquence pédagogique, son dévouement extrême à la cause et son exigence d'abord envers lui-même, puis envers les autres, ont été les fondements d'une affection sincère, marquée par l'admiration et la proximité.
C'est pourquoi le peuple ne ressentait pas le besoin de l'appeler par son nom de famille, c'est pourquoi le plus humble des citoyens osait le tutoyer ; et c'est pourquoi Fidel est alors devenu, et le demeure dans une large mesure, le paradigme du leader, parfois teinté de légende : celui qui pourrait tout résoudre et qui résume les qualités du Cubain, dont se targuent ceux qui sont nés ici : l'ingéniosité, la rébellion, le courage.
Toutefois, Fidel, qui fait désormais partie du patrimoine symbolique de la nation, doit être bien plus qu'un ressort émotionnel ; il le savait lui-même. C'est pourquoi il nous a poussés non pas vers le buste ou le nom de rue, mais vers l'étude de sa pensée et vers l'enrichissement indispensable et la continuité de ses idées.
Lui, qui a toujours été actif ne voulait pas être réduit à une leçon d'histoire froide et immuable. Aussi peut-il nous parler aujourd'hui de la construction de l'unité comme d'un processus jamais achevé, de l'établissement de consensus à partir d'une explication continue, de la sauvegarde de la culture avant tout, et de la confiance dans l'Île, qui est la confiance en ses hommes et en ses femmes, car il n'y a pas de plus grand revers que le découragement.
Aujourd'hui, nous commençons à célébrer le centenaire du Commandant en chef. Comme en 1953, lorsqu'un groupe de Cubains trouva en Marti les réponses à leurs inquiétudes et une dignité qui les éclairait, et décidèrent de ne pas laisser mourir l'Apôtre à l'occasion de son centenaire, cette célébration doit être l'occasion d'une étude rigoureuse de l'œuvre de Fidel, qui fut aussi un engagement envers les compagnons de cette génération, ni oubliés ni morts, qu’il honora de manière vertueuse.
Maintenant, nous pouvons être la génération du centenaire de Fidel, et cela n'implique pas de faire appel au génie – qu’il eut, c’est indéniable –, mais à sa pensée stratégique, à un concept élevé en tant que nation, au travail, à une certaine obstination et à un idéalisme fructueux, celui qui fonde les épopées et les soutient.
Ceux qui l'ont bien connu disent que ce n'était pas le fait que Fidel n'aimait pas perdre, mais qu'il luttait jusqu'à ce que cela n’arrive pas, qu'il s'obstinait jusqu'à vaincre, car les défis le faisaient grandir.
Entrons avec lui dans l'Histoire, et qu'obligatoirement, elle nous ouvre grand ses portes.









